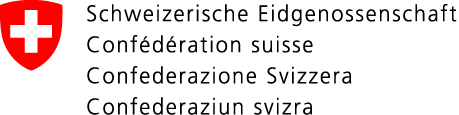Le service hivernal est une tâche de l’entretien courant des routes nationales, à l’instar notamment de l’entretien des bermes centrales, des talus et des équipements d’exploitation et de sécurité ainsi que du nettoyage des conduites d’évacuation des eaux, des aires de repos et des lieux où sont survenus des accidents.

Ces travaux doivent permettre la circulation la plus sûre possible sur les routes et l’utilisation optimale de ces dernières. Le service hivernal des routes nationales est une obligation juridique. Il existe 18 normes et réglementations sur cette thématique. Le service est actif d’octobre à avril.
La Confédération est responsable du service hivernal pour le réseau des routes nationales. Pour effectuer ce service l’Office fédéral des routes (OFROU) conclut des accords sur les prestations avec les 11 unités territoriales. Ces dernières s’occupent directement du service ou chargent des entreprises privées de l’accomplissement des tâches. Les 5 filiales de l’OFROU s’occupent des relations avec les unités territoriales.
50 centres d’entretien et centres d’intervention sont disposés le long des routes nationales afin de pouvoir intervenir rapidement sur tout le réseau.
Sur les autoroutes, le niveau de service est maximal: celui-ci prévoit un déneigement complet ainsi que des mesures de lutte contre le verglas.
En règle générale, les équipes ont l’obligation de procéder au premier passage du service hivernal dans les 2 heures après la mobilisation. Si la neige continue à tomber, des passages supplémentaires doivent être effectués.
Pour pouvoir garantir une entrée en fonction rapide, un service de piquet est assuré à tout moment ; les équipes sont opérationnelles 30 minutes après avoir reçu l’alerte.
Plusieurs collaborateurs aux professions diverses sont employés dans chaque centre d’entretien. La surcharge de travail découlant de l’occupation accrue pendant la période hivernale est généralement compensée en été. Pour faire face aux pics de travail, les centres d’entretien peuvent également s’adresser à des entreprises externes.
Les coûts fixes du service hivernal comprennent les dépenses pour la gestion et la surveillance, la formation ainsi que le service de piquet. À cela s’ajoutent les charges variables pour la lutte contre le verglas (salage) ou le déneigement, qui peuvent varier fortement selon les années : un hiver particulièrement froid entraînera des coûts de lutte contre le verglas plus importants, mais si les précipitations sont faibles, les heures d’intervention des chasse-neige seront moins nombreuses. Par contre, si la neige tombe en quantité, les chasse-neige devront passer plus souvent et plus longtemps. Ces facteurs influencent également le coût horaire pour chaque engin.
En ce qui concerne l’infrastructure des routes nationales, elle ne subit pas de problèmes majeurs pendant de longues périodes de froid. Par contre, les fluctuations de température autour du point de congélation ainsi que les précipitations provoquent des dommages et des frais importants.
50 centres d’entretien et centres d’intervention
Chacun des 50 centres d’entretien ou d’intervention dispose de 5 à 15 camions équipés de chasse-neige (d’une largeur de 3,5 à 6 m), d’épandeuses pour 4 à 6 m3 de sel et 2 m3 de saumure. Pour les tronçons où la neige ne peut pas être poussée sur les côtés, des turbines à neige sont nécessaires pour charger la neige sur les camions.
Quantités de sel
Au début de l’hiver, tous les entrepôts sont pleins: 64 000 tonnes de sel et 1900 tonnes de saumure sont stockées et prêtes à être épandues. Le sel est stocké dans des granges (jusqu’à 4000 tonnes) ou dans des silos (de 100 à 400 tonnes par silo). Ces derniers permettent au chauffeur de charger le sel dans son camion plus rapidement (2-3 minutes) et sans personnel supplémentaire.
En général, la quantité de sel répandue à chaque passage varie entre 5 et 20 g par m2 en fonction des conditions météo. À la fin de la saison hivernale, une quantité qui varie entre 8 et 40 tonnes de sel par kilomètre aura été utilisée.
De nouveaux systèmes de mesure s’appuient sur des thermomètres infrarouges permettant de relever en temps réel la température au sol et de doser le sel en conséquence. De tels systèmes sur une autoroute permettent de réduire de 20 à 25 % la quantité de sel sans aucune atteinte à la sécurité routière, ce qui profite à la fois à l’environnement et à l’économie dans la lutte contre le verglas.
Disposer d’informations météorologiques fiables et actuelles est une nécessité vitale pour le service hivernal. Les centres d’entretien disposent de deux sources d’informations principales:
- MeteoSuisse et d’autres instituts météorologiques fournissent aux centres d’entretien des prévisions à 24 h adaptées à leurs exigences : ces prévisions sont élaborées pour plus de 20 zones séparément.
- Tous les centres d’entretien disposent d’un système de capteurs intégrés au sol.
o Les capteurs routiers et les stations météo routières fournissent des informations sur les paramètres suivants : température de l’air à 2 m au-dessus du sol, température à la surface, humidité, point de condensation, température de congélation, précipitation, vent (direction et intensité), état de la route (sec ou mouillé), sel résiduel.
o Les stations locales fournissent des informations sur la température de l’air à 2 et 5 m au-dessus du sol, l’humidité et le point de condensation, les précipitations (type et quantité), la limite des chutes de neige, le vent (direction et intensité), la couverture nuageuse et l’état de la surface de la route.
Il n’y a pas d’obligation légale d’équiper son véhicule de pneus d’hiver en période hivernale. Pour autant, la recommandation de l’Office fédéral des routes (OFROU) est claire : des pneus adaptés à l’hiver sont indispensables pour circuler en toute sécurité durant cette saison. En effet, les pneus d’hiver offrent une meilleure adhérence sur des routes glissantes ou verglacées. Il est généralement préconisé de les utiliser d’octobre à Pâques.
La météo n’obéit pas toujours au calendrier
La Suisse est un territoire exigu si l’on considère sa topographie et son climat : il suffit de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour passer du Plateau, généralement peu enneigé et doux, à des régions de montagne où les routes sont recouvertes de neige. Si l’on imposait désormais l’utilisation de pneus d’hiver à partir du 1er novembre par exemple, une telle mesure serait déjà trop tardive selon la région ou les conditions météorologiques du moment. En résumé, il serait difficile d’instaurer sur l’ensemble de notre territoire une obligation d’utilisation de pneus d’hiver sur la base du calendrier.
Qu’entend-on par pneus d’hiver ?
La profondeur de sculpture minimale prescrite par la loi est de 1,6 millimètre, tant pour les pneus d’hiver que pour les pneus d’été. Cependant, les pneumatiques voient leurs propriétés routières importantes pour la sécurité, notamment l’adhérence dans la neige et la boue, se dégrader déjà bien avant. C’est la raison pour laquelle l’OFROU recommande de monter uniquement des pneus adaptés à l’hiver et présentant une profondeur de sculpture minimale de 4 millimètres (contre 3 mm pour les pneus d’été). Outre la profondeur de sculpture, des prescriptions légales plus poussées que les exigences techniques applicables aux pneus d’hiver rendraient la réglementation inextricable, car la palette des pneus d’hiver disponibles est large : ainsi, certains d’entre eux présentent d’excellentes propriétés sur les routes salées et mouillées, tandis que d’autres sont des pneus neige classiques. Il existe également des pneus mixtes et des pneus toutes saisons. Ces derniers font seulement office de compromis, dans la mesure où ils peuvent présenter des inconvénients aussi bien sur la neige que sur des routes sèches lorsque les températures sont élevées. Un pneu offrant une traction et un guidage latéral de qualité sur la neige sera le plus adapté aux véhicules ne circulant que sur les routes enneigées de l’Oberland grison. En revanche, les conducteurs parcourant des milliers de kilomètres sur des autoroutes salées et mouillées opteront pour un autre produit. Par conséquent, les exigences concernant la description des types de pneumatiques autorisés seraient extrêmement élevées et disproportionnées.
Laisser la voiture sur place
L’éventail de pneus d’hiver est aussi large que les prescriptions légales sur l’état de marche du véhicule sont claires : ce dernier ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement et répond aux prescriptions, de manière que les règles de la circulation soient observées et que les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Quiconque cause un accident ou perturbe fortement le trafic en conduisant avec des pneus d’été en hiver s’expose à une amende voire au retrait de son permis de conduire, et son assureur peut refuser de prendre en charge le préjudice. Par conséquent, lorsque la situation l’exige, il y a lieu de laisser la voiture sur place, même si celle-ci est équipée de pneus d’hiver, si les conditions de route ne permettent plus de continuer son chemin en toute sécurité.
Dans la lutte contre le verglas, on utilise aussi des produits à dégeler. Il s’agit en général de mélanges salins qui préviennent la formation de verglas sur la chaussée, même lorsque les températures sont très basses.
L’utilisation de tels produits dans le service hivernal doit se faire dans le respect de l’environnement. Il faut veiller à ce que les cours d’eau ne soient pas pollués par ces substances.
Le service hivernal sur les routes nationales se fait conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Une liste des produits autorisés pour la lutte contre le verglas figure dans l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.
Pour en savoir plus: Produits à dégeler (OFEV)